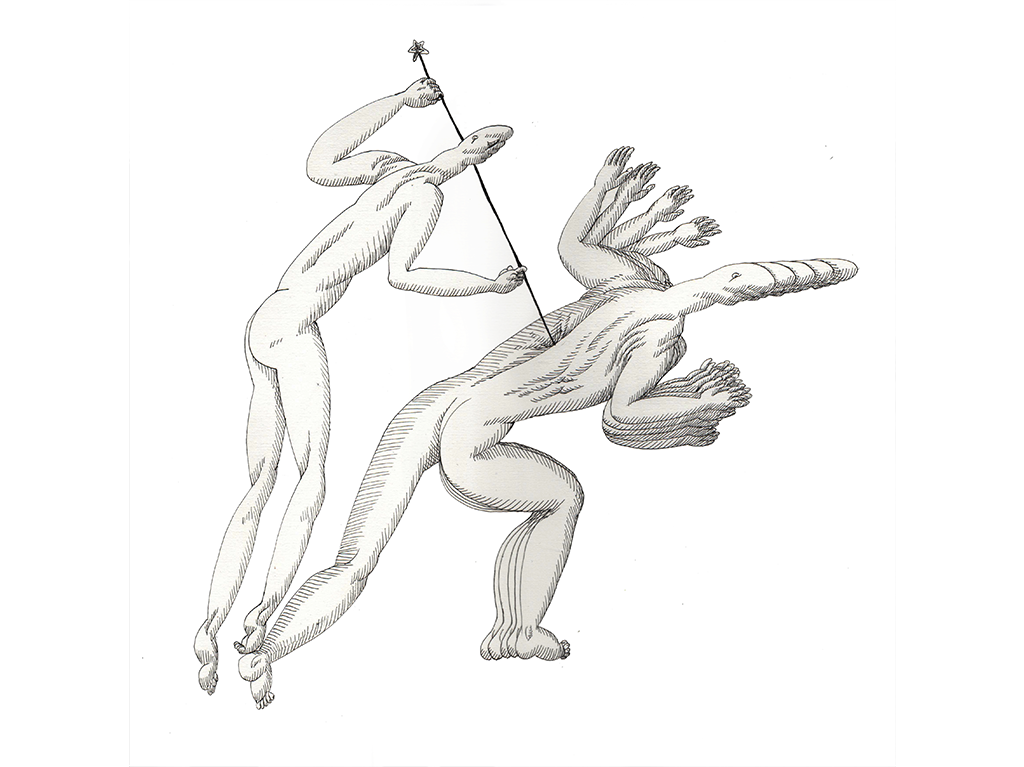
Un matérialisme contre une supercherie masculiniste
La vindicte d’hommes remontés se plaint périodiquement d’une prétendue « crise de la masculinité », effet pervers d’une révolution féministe qui aurait été trop loin, bouleversant la condition existentielle des mâles, provoquant mal-être, troubles sociaux et psychiques, allant jusqu’au suicide. Face à ce mythe, les discours libéraux ou axés sur l’identité ne peuvent fournir de réponse pertinente : d’où l’intérêt de le contrer par une analyse strictement matérialiste du patriarcat et de la construction des masculinités.
Faux alliés, vrais ennemis
Combien de vos amis ne vous ont pas dit une fois, en plus de l’éternel #notallmen, que les hommes souffraient aussi de la domination masculine, qu’il fallait leur faire confiance et qu’ils pouvaient prendre eux-mêmes leur destin en main, « travailler sur leur propre merde », pour glisser petit à petit, changer de discours insensiblement, se plaindre que « c’est trop difficile », « qu’il faut se mettre à notre place », voire qu’en fait « ce n’était pas si terrible que ça » pour proclamer à la fin qu’il n’y a « pas besoin de révolution », que les individus peuvent changer tout seuls, à leur rythme ? Combien d’autres, sensiblement sur un ton différent, ne se sont-ils pas révoltés sur la tyrannie des juges qui rendaient des pères « orphelins d’enfant » en donnant systématiquement la garde aux mères, ne se sont-ils pas plaints du taux de suicide masculin qui est très supérieur à celui des femmes, n’ont-ils pas déclaré que quand même, les hommes ont une espérance de vie bien moins longue que les femmes, qu’ « on se tue à la tâche pendant qu’elles ont le beau rôle », et qu’au final, on oublie toujours de parler des hommes victimes de violences conjugales et d’agressions sexuelles ? Les deux argumentaires masculins idéaux-typiques décrits ci-dessus, que l’on peut appeler d’une part « pro-féministe » et d’autre part « masculiniste », ne renvoient, on s’en doute, pas exactement aux mêmes personnes. Ces deux argumentaires s’incarnent certes au gré des situations et des rapports de force dans les corps et les esprits des hommes, mais il faut cependant noter que la frontière entre les deux est dangereusement poreuse : une fois que le faux allié passe le pas de la porte, il n’en revient qu’en ennemi dévoué.
De la victimisation indue à la radicalisation
Céder au second argumentaire, c’est préparer le chemin au backlash, à ce que la journaliste et théoricienne américaine Susan Faludi caractérise dans son livre éponyme comme un « retour de bâton » dans les années 1980 contre les avancées féministes survenues dans la société au cours de la décennie précédente. Néanmoins, la pseudo-crise de la masculinité que l’on a par exemple vu dénoncée dans la fameuse une de l’Obs d’août 2018 («Être un homme après #metoo ») ne suit pas la même stratégie politique. Tandis que le backlash décrit par Faludi s’appuie surtout sur la dénonciation orchestrée par les grands médias et l’industrie hollywoodienne des soi-disant conséquences dramatiques du féminisme sur les femmes elles-mêmes – prétendue dénatalité, épidémie d’infécondité, burn-out des femmes célibataires, effets négatifs des garderies –, en vue de pousser les femmes à se désolidariser de leurs camarades féministes, le but du mythe de la crise existentielle de la condition masculine opère cette fois en montrant les effets délétères du féminisme sur les hommes – pères orphelins, mal-être relationnel, « hominicides », taux de suicide démesuré –, les évertuant à ne pas se soumettre, voire à combattre le « diktat féminazi ».
Les conséquences de cette campagne d’intoxication et de désinformation peuvent, en dernière instance, mener au pire, alors même que toutes les actions qui imprègnent le continuum de violence sont déjà l’expression de sévices graduels. Comme ce n’est pas à moi de commémorer ce souvenir, je ne m’y attarderais pas ; mais il convient au moins de rappeler ce qui peut arriver de pire, à l’instar de la journée du 6 décembre 1989. On pourra trouver une étude plus approfondie sous la plume de la doctorante en sociologie Mélissa Blais dans J’haïs les féministes (2009). Ce jour-là, le dernier avant les examens, un homme débarque à Polytechnique Montréal, rentre dans une salle, demande aux femmes présentes de se placer à droite, aux hommes à gauche, et tire sur les femmes. Puis, il repart dans les couloirs. Avant de se faire lui-même sauter la tête, il aura tué quatorze femmes, treize étudiantes et une membre du personnel administratif. Dans la lettre trouvée sur son cadavre, on peut lire qu’il tient les féministes pour responsables d’avoir gâché sa vie, et qu’il trouve ses actes parfaitement rationnels, juste réaction contre celles qui chercheraient à « conserver les avantages des femmes […] tout en s’accaparant ceux des hommes. » Il avait déclaré dans la première classe : « Vous êtes des femmes, vous allez toutes devenir des ingénieures. Vous n’êtes toutes qu’un tas de féministes, j’haïs les féministes. Vous allez payer pour ça. » Il avait également dans la poche de sa veste une liste de 19 québécoises à abattre, parmi elles la première femme pompier de Montréal, la première commentatrice sportive, une éditorialiste d’un média de grande audience, etc. Selon Mélissa Blais, il s’agit du «premier féminicide contemporain de masse revendiqué ».
Mythologie de la crise de l’identité masculine
Le risque de voir d’autres hommes se radicaliser, devenir masculinistes, causer des violences y compris en France (d’autant plus qu’ils y sont renforcés dans leurs idées meurtrières par les médias dominants et certains polémistes) pousse à la nécessité de critiquer et de démasquer le mythe que représente cette prétendue crise du mâle. Pour cela, il est cependant impossible d’en appeler à une analyse fondée soit sur l’identité soit sur l’individu, puisque précisément cette crise entend décrire un mal-être, l’expression d’une psychologie de l’abandon dont les sujets masculins seraient victimes, le sentiment du déclin que ressentiraient les vrais hommes… Autant de choses que l’on ne peut ni ne doit prendre en compte à une échelle politique et sociale, car cette complainte de l’homme castré porte justement sur un mensonge primordial. En scrutant l’histoire occidentale, il ne peut en effet échapper au regard des historiennes du genre que cette idée de crise est absurde, le discours sur l’identité en crise étant constant : à Rome déjà, en 195 avant notre ère, Caton le Censeur écrivait que « les femmes sont devenues si puissantes que notre indépendance est compromise à l’intérieur même de nos foyers, qu’elle est ridiculisée et foulée aux pieds en public » (cité par Christine Bard et al., Antiféminismes et masculinismes d’hier à aujourd’hui, 2019). Pour le résumer schématiquement, les cris d’orfraie des hommes blessés dans leur orgueil retentissent à chaque fois que les revendications féministes prennent de l’ampleur. Toutefois, comme les revendications les plus vives ne surviennent pas à des époques où les rapports entre les genres peuvent discrètement tendre vers des formes d’égalité, mais bien plus lorsque la domination masculine s’insinue violemment dans tous les domaines de la vie, c’est lors de ces moments que l’on ressort du tiroir le vieux discours immémorial de la crise de la masculinité. Dans l’ouvrage du politologue Québécois Francis Dupuis-Déri qui a servi de source principale pour écrire cet article, La crise de la masculinité, autopsie d’un mythe tenace (2018), la structuration des moments féministes puis anti- féministes se découpe selon les moments suivants : renforcement du Patriarcat ; Révolution féministe ; Réaction ou contre-révolution masculiniste. Bien évidemment, la violence de la Réaction est telle qu’elle cherche à graver dans la chair l’emprise patriarcale, en essentialisant ou naturalisant une prétendue différenciation des sexes, qui conduit directement à la justification de leur hiérarchisation normative.
Face à la Réaction idéaliste : nécessaire critique matérialiste
Maintenant que l’on sait dans quel contexte historique apparaît la crise de la masculinité et ce qu’elle cherche à défendre, le statu quo patriarcal, il est clair que le chemin épistémologique qu’il convient de suivre pour critiquer pièce par pièce l’argumentaire masculiniste ne peut être lui-même fondé sur l’identité. L’intérêt du matérialisme pour les études des masculinités se fait ainsi crucial, en ce qu’il permet de neutraliser résolument l’artifice idéaliste du virilisme. Dans cette optique, il semble bien nécessaire de définir l’homme et le masculin, de manière matérialiste, et du même coup anti-essentialiste. Pour ce faire, rappelons que selon le jeune Karl Marx de L’idéologie allemande (1845-1846), une « conception matérialiste », conception scientifique positive, qui entend partir de faits effectifs, ne peut reconnaître que les faits suivants : « des individus déterminés qui ont une activité productive selon un mode déterminé entrent dans des rapports politiques et sociaux déterminés. » Néanmoins, comme l’on ne peut pas simplement suivre la doctrine marxiste au risque de voir la domination masculine se réduire simplement à un sous-système d’oppression découlant du capitalisme, il faut également se référer à la philosophe et sociologue Christine Delphy, qui propose dans l’Ennemi principal (2013) d’ « appréhender l’oppression des femmes à partir de sa base matérielle », d’étudier, selon le sous-titre du premier tome, l’ « économie politique du patriarcat ». Réaliser cet examen revient, selon les termes employés par Pauline Clochec dans l’introduction à l’ouvrage Matérialismes trans (2021), à « rendre compte de l’oppression des femmes à partir de leur position dans les rapports de production ». Ces rapports de production sont autant capitalistes que patriarcaux, existent dans le cadre du travail salarié comme dans le cadre du « travail gratuit » (selon l’expression de Delphy), ce dernier comprenant autant l’exploitation domestique que l’exploitation sexuelle. Ce « double travail » fonctionne ainsi sur la base de deux principes différents : d’une part la participation active des femmes au marché du travail et leur aliénation, au même titre que les travailleurs, ainsi que d’autre part la reproduction des conditions mêmes de ce marché du travail, le «travail reproductif » assumé par les femmes permettant la recomposition de la force de travail – cette précision étant apportée par Silvia Federici dans Le capitalisme patriarcal (2019). On pourrait croire que j’ai changé de sujet, il n’en est rien : dans une société où, sur le modèle des classes sociales de Marx, la « classe des hommes » opprime économiquement et socialement la « classe des femmes », on ne peut définir le masculin que par les relations d’inégalité et de hiérarchie qu’il entretient avec le féminin. Dans cette mesure, il ne s’agit pas de donner une identité à la masculinité, mais de décrire l’ « identité politique » des hommes, non une quelconque identité individuelle fantasmée. Il faut donc reconnaître, par exemple avec Francis Dupuis-Déri, qu’ « être un homme implique tendanciellement avoir certains privilèges, la possibilité d’exercer des rapports de domination, d’avoir des attentes et d’obtenir (même quand on ne demande rien d’ailleurs) des services de la part de femmes. »

Crise identitaire convulsive du suprémacisme mâle
Toutefois, ne définir l’identité politique masculine que par une inversion de l’identité politique féminine reviendrait à manquer de vue quelque chose, à ne pas comprendre la véritable portée du discours de la crise de la masculinité. En regardant de près les porteurs de ce discours, on se rend compte en effet que n’importe qui – ce qui vaut pour l’homme auto-déclaré pro-féministe comme pour le masculiniste convaincu – est tenté de croire à un moment ou à un autre, le mythe selon lequel les victimes du patriarcat, et plus encore de la révolution féministe, seraient les hommes. Mais comment cela est-il possible, alors même qu’il n’est pas absurde de postuler que tous les hommes ne sont pas nécessairement de mauvaise foi ? C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’ajouter à la définition politique de l’identité masculine un aspect proprement social, et notamment à l’aide du concept de « suprématie mâle », circonscrit par la philosophe étatsunienne Marilyn Frye dans The Politics of Reality (1983). Selon elle, cette notion explique que le sentiment que quelque chose est dû aux hommes par le simple fait qu’ils soient des hommes est majoritairement partagé, ce que l’anglais entitled traduit tout à fait (c’est-à-dire avoir un droit sur quelque chose parce qu’on possède un « titre » particulier). De même, le suprémacisme mâle contient en lui la mise en avant de l’homoérotisme ou homosociation, ce qui revient pour un homme à conserver exclusivement son respect et son admiration à d’autres hommes, et à justifier une prétention à une non-mixité masculine dont le boys club est l’exemple paradigmatique. Enfin, pour ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, ce concept explique, grâce à l’expression empruntée au vocabulaire aristocratique de « crime de lèse-majesté », la violence immédiate, non-proportionnelle et souvent non-réflexive, en réaction à la moindre remise en cause des privilèges qu’un homme croit avoir du seul fait qu’il est un homme.
J’insiste sur le principe de non-réflexivité et d’immédiateté du rappel à l’ordre suprémaciste, qui explique la crédulité donnée a priori à une éventuelle vérification du discours de la crise du mâle. De fait, pour un homme qui se croit dans un ordre hiérarchique, celui-ci constituant la structure normative indiscutable du tissu social, qui est censée lui revenir de droit représente pour lui une menace vitale à l’édifice sacré de la société juste et bonne. De là le fameux «soutien total et inconditionnel» des pairs d’un homme accusé de violences ; pour eux, il faut se serrer les coudes, car l’accusation d’individus provenant de couches sociales considérées comme naturellement inférieures ne peut qu’être illégitime et dangereuse. Dans ce cadre, peu importe que l’accusation soit vraie ou fausse, il faut la croire fausse par principe, car elle apparaît comme injuste en elle-même. Et ce qui vaut pour une accusation individuelle vaut pour une accusation collective : si l’on soupçonne la caste des hommes d’être coupables de quoi que ce soit, tout discours qui présenterait l’inverse, les hommes comme victimes, semble être d’une logique imparable. Pourtant, il faut bien avouer que tous les arguments qui abondent le discours de la crise de la masculinité sont faux. Par exemple, le taux de suicide effectif des hommes est, c’est un fait, supérieur à celui des femmes ; toutefois, le taux de tentatives de suicide est sensiblement le même pour les hommes comme pour les femmes. Comment comprendre cette différence, dans une recherche matérialiste, socioéconomique des causes ? Il faut d’abord constater que la masculinité est le résultat d’une construction sociale, de l’acquisition d’une virilité grâce à une socialisation différenciée, et que cette socialisation masculine implique certains faits culturels, notamment un rapport décomplexé à la violence qui se conjugue, dans certains pays, d’une possession fréquente d’arme à feux. A l’inverse, la socialisation féminine enseigne tendanciellement un rapport distancié à la violence, et une intériorisation de celle-ci. Tout ceci entraîne une inégalité de genre face au suicide, les femmes en réchappant bien plus du fait même que les expédients choisis soient sociologiquement moins mortels (overdose de médicaments, usage d’une arme blanche…). Les taux masculins et féminins sont ainsi différenciés par le simple fait de contraintes sociales. Non, le suicide n’est pas la conséquence d’un malaise existentiel de la condition masculine.
Quant à la suite des arguments à démonter, ce n’est pas ici mon affaire, je vous renvoie à l’ouvrage de Francis Dupuis-Déri sur la question. Mais rappelez-vous que si vous doutez par principe de cette référence, peut-être que la suprématie mâle n’est pas loin !
Marin Lagny




