
Renouveau matérialiste dans la pensée féministe contemporaine
S’enquérir du retour du matérialisme aujourd’hui et de son usage crucial pour balayer les relents masculinistes et menaces antiféministes, mais aussi pour aller jusqu’au bout des implications philosophiques absentes des réflexions des années 1970, c’est nous donner les moyens de mettre au jour les insuffisances des systèmes capitalistes et libéraux lorsqu’ils prétendent défendre la « cause des femmes ». Nous avons choisi d’ouvrir ce nouveau volet de l’Enquête philo’ par un entretien avec Pauline Clochec, maîtresse de conférence à l’université d’Amiens, spécialiste de philosophie allemande et de la pensée féministe. Militante issue du courant lesbien radical, elle a notamment dirigé avec Noémie Grunenwald l’ouvrage Matérialismes Trans.
MATÉRIALISME ET IDENTITÉ
Le Médiaphi – Comment présenterais-tu Matérialismes trans en quelques mots ?
Pauline Clochec – C’est un ouvrage collectif, issu de la journée d’étude « Matérialismes trans » qui a eu lieu à l’ENS de Lyon il y a deux ans et regroupe des contributions diverses, parfois en tension du point de vue de leur contenu, mais dont le projet commun est de comprendre les réalités vécues par les personnes trans à partir d’un cadre théorique et politique féministe matérialiste. Cela implique de ne plus penser la «transitude» comme une affaire d’identité, de genre qui serait intérieur et individuel, mais comme une réalité sociale, de considérer ce phénomène comme quelque chose qui impacte l’existence sociale et économique des individus.
Le terme transidentité est souvent employé pour décrire les parcours de vie trans, mais vous préférez celui de « transitude ». Quelle distinction entre les deux ?
Le problème du terme transidentité, c’est qu’il implique déjà une thèse sur ce qu’est le fait trans, à savoir une réalité intérieure, d’ordre psychique, une identité de genre individuelle. L’emploi du terme transitude est québécois à l’origine, c’est un terme suffisamment large qui ne préjuge pas de ce qu’est être trans mais permet de décrire cette réalité. Pour ma part, je préfère employer les termes de transexualité ou transexuation qui me semblent plus précis et permettent surtout d’introduire la dimension du sexe, de bien montrer qu’il s’agit d’un changement de classe de sexe et qu’il y a aussi des aspects physiques à la transition. C’est plus polémique évidemment.
Quels rapports les textes de votre ouvrage entretiennent- ils avec des autres approches plus contemporaines de la transitude ?
Il y a vraiment un souci de rupture avec les conceptualisations queer de la transitude comme transidentité qui se limitent à cette approche très psychologisante et un peu tokénisante [NDLR : fétichisante] des trans comme performant une subversion de genre. En réalité, ce n’est pas une évidence que les personnes trans subvertissent le genre, et si elles le font, c’est plutôt dans leur sexe d’arrivée, en exprimant une identité marginale par rapport à la norme de genre masculine ou féminine. S’il y a des éléments de rupture avec les approches queer, par exemple représentées par certains articles de Judith Butler ou d’Elsa Dorlin, ce n’est pas une rupture avec toutes les personnes qui parlent de transidentité. Quand j’ai commencé à critiquer ce terme, dans une conférence en 2018, Karine Espineira – qui a contribué à introduire le terme en France – était plutôt d’accord avec mes critiques mais elle expliquait qu’à l’époque où elles ont commencé à diffuser ce terme dans les années 2000, le mot « trans- sexualisme » était omniprésent et employé de manière psychiatrisante et pathologisante, d’où le besoin d’un contre-mot qui permettrait d’établir un contre-discours. Je comprends aussi ces besoins-là qui ont une histoire, mais je pense qu’aujourd’hui le moment où on avait besoin du terme transidentité est peut-être dépassé.
Quels sont les problèmes posés par le discours sur l’identité développé pour théoriser les parcours de vie trans ?
C’est large ! Il y a plusieurs problèmes. Le premier, selon moi, est un problème descriptif : ce discours ne rend pas compte de ce que c’est que changer de sexe, à la fois dans la partie où on est actif·ves – c’est-à-dire dans les actes de transition sociaux, corporels, juridiques – et en même temps dans la partie où on est passif·ves – c’est-à-dire dans la manière dont la société nous traite et nous perçoit. Tout ça n’est pas une question d’identité, c’est une question d’appartenance collective, ce n’est pas d’âme que tu changes. Cette idée de « se sentir femme », je n’ai aucune idée de ce que ça voudrait dire, par contre je sais ce que c’est qu’être une femme socialement, en termes de possibilités de carrière, de traitement par les collègues et dans la rue, dans le métro, de comment se répartit la parole dans un groupe. Ce qui change vraiment c’est l’appartenance à un groupe marqué socioéconomiquement, c’est-à-dire à une classe, une classe de sexe.
J’ai parlé du deuxième problème, d’ordre normatif, dans une conférence qui avait fait couler beaucoup d’encre et qui s’appelait : « nos identités sont-elles politiques ? » Il me semble que focaliser la description de la transitude sur l’identité, et donc sur un phénomène psychique, a un effet de délégitimation du changement de sexe car cela passe pour quelque chose de seulement intérieur. Beaucoup de transphobes ont alors beau jeu de répondre que si c’est seulement dans la tête, c’est un peu ridicule, c’est un caprice. Il faut au contraire avancer l’idée matérialiste que changer de sexe c’est précisément plus qu’un changement identitaire et psychique : c’est changer de catégorie sociale, c’est changer la perception des autres sur soi, c’est être traité d’une autre manière. Ce qui fonde le fait que les femmes trans puissent dire « oui, je suis bien une femme », que les hommes trans puissent dire « oui, je suis bien un homme » et peut-être que les personnes non-binaires puissent dire « oui, je suis bien non-binaire », c’est que cela est lié à leurs corps, leur vie sociale et leur place dans la société.
Troisièmement, cette focalisation sur l’identité a souvent tendance à être corrélée à une conceptualisation assez irénique, assez pacifiée, heureuse des transitions, présentées alors comme des moments d’euphorie de genre. Mais c’est oublier que dans la réalité, de nombreuses personnes sont malheureuses parce qu’elles vivent un certain nombre de dominations et de marginalisations sociales. À mon sens, il faut éviter de fixer de nouvelles normes d’acceptabilité des transitions, comme l’idée qu’il faut éprouver de l’euphorie de genre par exemple ou que la transition rendrait heureux·se, sans quoi on ne pourra jamais concevoir une transition achevée.
Ce discours s’inscrit-t-il aussi dans un moment libéral ?
Il faudrait sans doute détacher l’effet libérateur de la transition du paradigme libéral, qui postule que l’épanouissement de l’individu se fait dans une bulle purement isolée. Pour mieux comprendre, au contraire, il faut réinscrire ce moment au cœur d’une reconfiguration des liens sociaux qui s’opère au moment de la transition : le changement du cercle amical, le changement de boulot, le fait d’arriver dans des espaces où les gens n’ont pas connu ta période de transition. Certaines approches contemporaines comme les appréhensions queer de la transitude sont quant à elles dépendantes d’un paradigme culturel individualiste, qui est le paradigme propre à l’époque bourgeoise, propre au fait de faire de l’individu la pierre de touche de la société, de le penser indépendamment de ses relations sociales de dépendance. Cette conception bourgeoise, (qu’on appelle libérale aujourd’hui) est très active dans les théorisations queer, notamment car ces théorisations ont émergé dans un contexte qui est celui d’un reflux des luttes sociales. Les théories queer sont nées d’une prétendue troisième vague mais qui n’est pas une troisième vague, qui est plutôt une époque de reflux des mouvements féministe et ainsi plutôt un deuxième reflux qu’une troisième vague. Elles sont marquées théoriquement par la dissolution de tout un nombre de solidarités qui avaient marquées la période précédente des années 1970- 1980 encourageant des pensées plus collectives.
Les théories queer sont nées d’une prétendue troisième vague mais qui n’est pas une troisième vague, c’est plutôt une époque de reflux des mouvements féministes, une sorte de deuxième reflux plutôt qu’une troisième vague.
POUR UNE BIOLOGIE MATÉRIALISTE
Que change l’approche des corps que tu développes dans le chapitre que tu signes dans cet ouvrage : « Les conditions sociales de l’accès au corps. Pour une théorie matérialiste des corps à partir de la transsexuation »?
Je traite la question de l’accès aux soins et à la santé et la question du corps comme deux problèmes importants, à la fois sociologiquement et philosophiquement. J’essaie de soutenir que l’expérience que l’on fait de notre corps n’est jamais une pure expérience en première personne, séparée de tout conditionnement ou toute médiation d’autrui, et que toute médiation sociale peut mettre des obstacles entre l’individu et son corps, sous la forme d’une restriction de l’autonomie corporelle par exemple. L’aspect sociologique consiste à remarquer que cette situation de privation d’accès à son propre corps n’est pas répartie de manière aléatoire dans la société mais qu’elle est opérée à travers des procédures de contrôle, des « procédures d’appropriation » des corps des femmes écrirait Colette Guillaumin, en tant que groupe social déterminé – la classe des femmes – par un autre groupe social déterminé – la classe des hommes.
Ce que j’ai essayé de penser à travers mon article c’est que les limites mises à la transition, par exemple le fait de subir un diagnostic psychiatrique, ne sont pas propres à groupe social marginal particulier qui serait celui des trans, mais qu’elles prennent sens dans le cadre d’une appropriation plus générale du corps des femmes. Selon moi, ce sont les mêmes logiques à l’œuvre dans la limitation de l’avortement, dans la limitation de la contraception ou à l’inverse dans la contrainte à la contraception, que celles qui s’expriment lors des procédures de contrôles des transitions. Ce n’est d’ailleurs pas seulement les mêmes logiques formelles qui sont à l’œuvre mais également les mêmes personnes et les mêmes institutions qui les opèrent : ainsi, c’est la question de l’indisponibilité du corps des femmes qui est en même temps mobilisée par le droit et par le corps médical contre l’avortement, et en même temps employé par les mêmes personnes pour s’opposer à l’opération des personnes trans. C’est en ce sens, à mon avis, que les combats pour les droits des trans à transitionner comme iels le veulent n’ont de sens que s’ils sont menés dans la perspective plus large de l’autonomie corporelle des femmes.
Quel est l’enjeu politique d’une réappropriation de la question du corps et la biologie ?
Je tiens à la question du corps et de la biologie, car en réalité, le problème de la position cis-sexiste, ce n’est pas qu’elle définit les corps sexués à partir de la biologie, mais qu’elle le fait à partir d’une conception fixiste de la biologie qui ne prend pas en compte le fait que le corps est un support de données biologiques assez plastique pour qu’une personne puisse véritablement changer de sexe au cours de sa vie. En effet, on ne peut pas soutenir qu’un homme trans reste une femelle et qu’une femme trans reste un mâle, puisqu’il y a bien un changement hormonal, génital et de caractères sexuels secondaires qui font que ces personnes deviennent biologiquement des femmes et des hommes. Ce n’est pas seulement par naturalisme que pêche la position cis-sexiste, c’est à cause d’une conception simpliste de la biologie de la sexualité.
Le corps est un support de données assez plastique pour qu’une personne puisse véritablement changer de sexe
DIVERGENCES & SOLIDARITÉS
Comme tu le rappelles dans la préface, le concept de « matérialisme » est emprunté à Marx. Quel rapport critique entretiens-tu avec le marxisme ?
Comme je suis tatillonne, je dirais que je ne suis pas marxiste mais marxienne (les marxistes pensent que Marx avait déjà tout dit). En fait, le féminisme matérialiste s’est construit dans un double rapport à Marx, à la fois un rapport d’héritage en reprenant l’idée que les luttes juridiques, culturelles et politiques doivent être ramenées à une base matérielle – celle des rapports socio-économiques -, et en même temps, c’est un héritage constamment critiqué car les analyses de Marx sont indifférentes à la division sexuée du travail. Le courant purement marxiste n’est pas du tout celui dans lequel je m’inscris, car il subordonne la lutte antipatriarcale à la lutte anticapitaliste. L’apport de Christine Delphy, au contraire, c’est précisément de nous permettre de penser l’autonomie légitime de la lutte féministe.
Contrairement à ce qu’on dit souvent, Delphy est très prudente ; elle ne prétend pas que le patriarcat préexiste au capitalisme, alors que Silvia Federici dirait qu’ils naissent en même temps, de manière corrélée. D’ailleurs, Delphy rappelle qu’elle écrit sur les rapports sociaux de sexe des XIX-XXème siècles, parce qu’en tant que sociologue il lui faut réaliser des travaux de petite ampleur pour ne pas avoir des concepts trop larges qui prétendraient tout expliquer d’un coup, mais qui perdraient alors une attention cruciale à la contextualité historique. C’est pourquoi, quand Delphy parle de patriarcat, elle ne parle pas d’une structure sociale existant depuis le néolithique.
Ce qui est certain, c’est qu’il y a des régimes de différenciation et de hiérarchisation des sexes antérieurs à l’époque moderne, mais je pense qu’il faut prêter une attention particulière à la manière dont ils évoluent, car ce qui est choisi en tant que critère définitoire pour différencier et hiérarchiser change avec les époques que ce soit en termes de définition corporelle ou anatomique des sexes, en termes culturels, en terme de position sociale, pour savoir quelle valeur on va associer à tel sexe et à tel autre. On peut dire que différentes configurations patriarcales ont existé voire existaient avant le capitalisme, mais l’émergence du capitalisme a aussi eu des effets culturels, sociaux, économiques sur les formes nouvelles des patriarcats.
À la suite de Christine Delphy, vous reprenez le concept de « classe de genre ». Pourquoi réintroduire ce concept aujourd’hui ?
Effectivement, c’est un concept que l’on reprend notamment à Delphy, même s’il a été forgé de manière un peu collective par les féministes radicales des années MLF (Mouvement de Libération des Femmes). C’est un concept qui permet de signaler que la division entre les femmes et les hommes s’opère par des rapports d’exploitation du travail (et non par de simples rapports idéologiques de dévalorisation du féminin), mais aussi par des rapports bien réels de positions sociales dans lesquelles sont mises les femmes, principalement à travers leur assignation au travail domestique au sens large, et du fait de la « division sexuée du travail » théorisée par Danièle Kergoat.
Là où il y a une distance avec Delphy, en tout cas pour ma part, c’est que du fait de sa position très en retrait voire hostile au féminisme lesbien puis au lesbianisme radical dans les années 1980, après la scission de Questions Féministes, elle a eu tendance à surinvestir dans cette constitution des classes de sexe l’aspect d’exploitation économique sans se poser la question de l’exploitation sexuelle ni la question de la contrainte à l’hétérosexualité qui force les femmes à entrer dans des relations de dépendances avec des hommes et des relations d’exploitations sexuelle. C’est d’ailleurs ce que Monique Wittig reproche à Delphy dans son article « Les questions féministes ne sont pas des questions lesbiennes ». À mon sens, c’est une erreur de séparer le patriarcat de l’hétérosexualité ; la contrainte à l’hétérosexualité n’est pas seulement quelque chose qui s’ajoute au patriarcat, mais c’est quelque chose qui en est constitutif, à la fois de la division culturelle entre femmes et hommes mais également de la hiérarchisation sociale qui s’en suit.
De plus, Christine Delphy n’est pas totalement cohérente avec son constructivisme. D’un côté elle développe une pensée constructiviste sociale du sexe, en écrivant que « le genre précède le sexe », c’est-à-dire que ce sont les rapports d’exploitation et de hiérarchisations qui constituent socio-culturellement l’idée d’une différence des sexes, et que c’est cette idée qui vient justifier a posteriori des rapports d’exploitation ; de l’autre côté, elle a une certaine tendance, dans la lignée de Simone de Beauvoir d’ailleurs, à faire rentrer certains aspects naturalistes par la fenêtre après les avoir sortis par la porte, en ne pensant pas la possibilité de la transsexualité notamment. Cycliquement, elle a des propos transphobes qui laissent deviner que c’est une question à laquelle elle n’a jamais pensé. Or, quand elle a des propos cis-sexistes, elle est juste complètement en désaccord avec son constructivisme, car ça implique de remettre de la naturalité de naissance dans la définition de ce qui fait le sexe, alors que dans son article «L’ennemi principal» elle parle d’ « hommes sociaux » et de « femmes sociales ».
Quelle incidence pour les luttes ?
D’une part, elle développe une théorie de l’autonomie de la lutte féministe et le fait que les femmes doivent s’organiser indépendamment des hommes, contre eux parfois, et dans des organisations non-mixtes qui ne se mettent pas sous la coupe de partis, de syndicats mixtes. D’autre part, elle fixe un objectif d’abolition du genre (l’abolition du patriarcat et de l’hétérosexualité). Voilà un double principe politique qui guide ma pratique militante. Delphy n’est pas la seule à le dire, mais les féministes qui s’appelaient radicales et qu’aujourd’hui on appelle matérialistes des années 1970 l’ont vraiment porté avec beaucoup de force par rapport aux féministes marxistes aux féministes marxistes qui militaient dans des organisations mixtes. Selon moi, cette exigence de non-mixité doit continuer à alimenter les luttes féministes et même plus largement que dans le militantisme : elle doit alimenter le plus possible tous les pans de vie sociale des femmes.
Entretien réalisé le 6 novembre dernier par Zéphora Rousseau dans un bar du 11ème arrondissement (Paris), le Bonjour Madame.




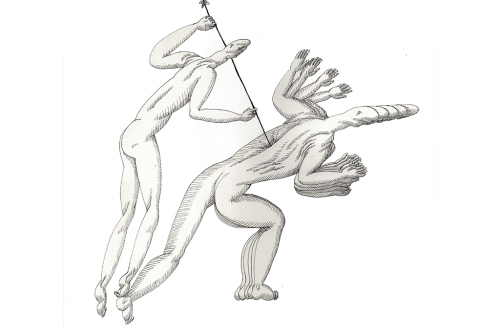
2 Comments
Pingback:
Pingback: